Journées d’étude du programme APIM (Atlas des ports et itinéraires maritimes de l’Islam médiéval) dans le cadre de l’ANR MEDIAN.
Représentations idéalisées et réalités matérielles (textes – images – archéologie)
7-8 octobre 2010
Paris, Bibliothèque nationale de France (site Richelieu)
CNRS, 27, rue Paul Bert, 94200 Ivry-sur-Seine
Accès libre dans la limite des places disponibles.
Paris, Bibliothèque nationale de France (site Richelieu)
CNRS, 27, rue Paul Bert, 94200 Ivry-sur-Seine
Accès libre dans la limite des places disponibles.
Organisées par : - Laboratoire Islam médiéval (UMR 8167)
Organisées par : - BNF / Cabinet des cartes et plans
Organisées par : - Avec le soutien du CEFAS (Centre français d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa)
Organisées par : - de l’Agence nationale de la recherche (ANR)
Organisées par : - BNF / Cabinet des cartes et plans
Organisées par : - Avec le soutien du CEFAS (Centre français d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa)
Organisées par : - de l’Agence nationale de la recherche (ANR)
Responsables : - Monique Kervran,
- Michel Tuchscherer,
- Eric Vallet
Pour tout renseignement, contact : evallet[at]univ-paris1.fr
De Qulzum à Sîrâf, d’Aylat à al-Ahsâ’, l’Arabie est entourée par un chapelet de sites portuaires qui ont joué un rôle essentiel dans son histoire. Longtemps considérés comme des espaces en marge, souvent décrits sous les traits d’une insularité fictive ou réelle, les ports de l’Arabie ont connu d’importantes transformations dans leur répartition, leur organisation spatiale et leurs relations avec leurs arrière-pays continentaux ou leurs « avant-pays » littoraux, depuis l’avènement de l’Islam jusqu’à l’établissement des hégémonies modernes, portugaises ou ottomanes. Reconstituer l’histoire de ces ports – telle est l’ambition du programme APIM – réclame un dialogue entre spécialistes des sources textuelles et des sources matérielles issues de l’archéologie. L’étude du fait portuaire se situe en effet au croisement de plusieurs perspectives historiques : celles de la longue durée, appuyée sur la permanence relative des structures de l’échange et de l’occupation des sols ; celles de l’éphémère, de l’événement, de la succession chronologique des faits politiques et militaires, dans des régions marquées par un fort éclatement des pouvoirs (tribus, cités, États). Rendu visible par les découvertes archéologiques de plus en plus nombreuses, le fait portuaire dans les mers de l’Arabie reste plus difficile à appréhender à partir des textes écrits en arabe, persan, latin ou portugais.
Sans prétendre à une couverture exhaustive de l’histoire de tous ces ports, cette journée d’étude visera à approfondir deux points en particulier, en s’appuyant sur les données rassemblées dans le cadre de la base APIM :
Nous nous intéresserons tout d’abord à l’évolution de la représentation de ces ports dans les sources écrites, en particulier dans les schémas, dessins, gravures, qui émergent à compter du XIIIe siècle, avant de se multiplier au XVIe siècle. L’évolution de la représentation des ports dans la cartographie sera évaluée en parallèle. Comment expliquer cette efflorescence des représentations figurées des ports des mers de l’Arabie, de la mer Rouge au Golfe Arabo-Persique ? Cela traduit-il une simple évolution du regard ? une appréhension nouvelle du fait portuaire ?
Les différentes communications auront pour but, d’une part, de proposer un panorama le plus vaste possible de ces représentations iconographiques du VIIe au XVIe siècle, de cerner les contours des corpus et d’envisager les problèmes que pose spécifiquement leur étude. D’autre part, elles proposeront des pistes d’analyse afin de mieux comprendre les enjeux de cette « mise en image » des sites littoraux (rapport entre texte et iconographie ; critères de choix des ports représentés, de sélection des éléments naturels ou bâtis décrits ; dimensions politiques et militaires des documents ; usages, réception et diffusion).
Durant la période considérée, seuls quelques ports ont les honneurs de la représentation iconographique. Ce sont en même temps souvent les sites côtiers les plus importants, à la tête de réseaux transrégionaux à la fois politiques et économiques établis sur la longue durée, sans être pour autant immuables. Dans la région du Golfe et de la mer d’Oman, sept ports se distinguent en particulier entre le viie et le xvie siècle : Baṣra, Sīrāf, Qays, Ṣuḥār, Hurmūz, Qalhāt et Mascate. Nous chercherons à mieux comprendre quels furent les fondements de ces hégémonies portuaires successives ou concurrentes. Les ports les plus éminents du Golfe et de la mer d’Oman présentent-ils des caractères identiques d’un bout à l’autre de la période (morphologie urbaine et gestion des espaces littoraux ; activités économiques, artisanales et navales ; rapports entre pouvoir politique et monde marchand) ? Les ressorts de leur domination sont-ils similaires ?
Pour chacun de ces ports, historiens des textes et archéologues seront invités à confronter, dans un esprit de synthèse, leurs données respectives. Ils accorderont une attention particulière à la façon dont le rôle central de ces ports se manifeste dans les sources disponibles, non sans des décalages fréquents entre les représentations idéalisées des textes et les données plus prosaïques des vestiges matériels.
- Michel Tuchscherer,
- Eric Vallet
Pour tout renseignement, contact : evallet[at]univ-paris1.fr
De Qulzum à Sîrâf, d’Aylat à al-Ahsâ’, l’Arabie est entourée par un chapelet de sites portuaires qui ont joué un rôle essentiel dans son histoire. Longtemps considérés comme des espaces en marge, souvent décrits sous les traits d’une insularité fictive ou réelle, les ports de l’Arabie ont connu d’importantes transformations dans leur répartition, leur organisation spatiale et leurs relations avec leurs arrière-pays continentaux ou leurs « avant-pays » littoraux, depuis l’avènement de l’Islam jusqu’à l’établissement des hégémonies modernes, portugaises ou ottomanes. Reconstituer l’histoire de ces ports – telle est l’ambition du programme APIM – réclame un dialogue entre spécialistes des sources textuelles et des sources matérielles issues de l’archéologie. L’étude du fait portuaire se situe en effet au croisement de plusieurs perspectives historiques : celles de la longue durée, appuyée sur la permanence relative des structures de l’échange et de l’occupation des sols ; celles de l’éphémère, de l’événement, de la succession chronologique des faits politiques et militaires, dans des régions marquées par un fort éclatement des pouvoirs (tribus, cités, États). Rendu visible par les découvertes archéologiques de plus en plus nombreuses, le fait portuaire dans les mers de l’Arabie reste plus difficile à appréhender à partir des textes écrits en arabe, persan, latin ou portugais.
Sans prétendre à une couverture exhaustive de l’histoire de tous ces ports, cette journée d’étude visera à approfondir deux points en particulier, en s’appuyant sur les données rassemblées dans le cadre de la base APIM :
Nous nous intéresserons tout d’abord à l’évolution de la représentation de ces ports dans les sources écrites, en particulier dans les schémas, dessins, gravures, qui émergent à compter du XIIIe siècle, avant de se multiplier au XVIe siècle. L’évolution de la représentation des ports dans la cartographie sera évaluée en parallèle. Comment expliquer cette efflorescence des représentations figurées des ports des mers de l’Arabie, de la mer Rouge au Golfe Arabo-Persique ? Cela traduit-il une simple évolution du regard ? une appréhension nouvelle du fait portuaire ?
Les différentes communications auront pour but, d’une part, de proposer un panorama le plus vaste possible de ces représentations iconographiques du VIIe au XVIe siècle, de cerner les contours des corpus et d’envisager les problèmes que pose spécifiquement leur étude. D’autre part, elles proposeront des pistes d’analyse afin de mieux comprendre les enjeux de cette « mise en image » des sites littoraux (rapport entre texte et iconographie ; critères de choix des ports représentés, de sélection des éléments naturels ou bâtis décrits ; dimensions politiques et militaires des documents ; usages, réception et diffusion).
Durant la période considérée, seuls quelques ports ont les honneurs de la représentation iconographique. Ce sont en même temps souvent les sites côtiers les plus importants, à la tête de réseaux transrégionaux à la fois politiques et économiques établis sur la longue durée, sans être pour autant immuables. Dans la région du Golfe et de la mer d’Oman, sept ports se distinguent en particulier entre le viie et le xvie siècle : Baṣra, Sīrāf, Qays, Ṣuḥār, Hurmūz, Qalhāt et Mascate. Nous chercherons à mieux comprendre quels furent les fondements de ces hégémonies portuaires successives ou concurrentes. Les ports les plus éminents du Golfe et de la mer d’Oman présentent-ils des caractères identiques d’un bout à l’autre de la période (morphologie urbaine et gestion des espaces littoraux ; activités économiques, artisanales et navales ; rapports entre pouvoir politique et monde marchand) ? Les ressorts de leur domination sont-ils similaires ?
Pour chacun de ces ports, historiens des textes et archéologues seront invités à confronter, dans un esprit de synthèse, leurs données respectives. Ils accorderont une attention particulière à la façon dont le rôle central de ces ports se manifeste dans les sources disponibles, non sans des décalages fréquents entre les représentations idéalisées des textes et les données plus prosaïques des vestiges matériels.
-
Plus d'informations, programme et sources : « Les ports des mers de l'Arabie et de la Perse, VIIe-XVIe siècle », Journée d'étude, Calenda, publié le lundi 27 septembre 2010, http://calenda.revues.org/...
Voir aussi median.hypotheses.org/... (Rencontres MedDian) et ANR 1 Ports du Golfe et de l'Arabie prog définitif (PDF / HTML).
-





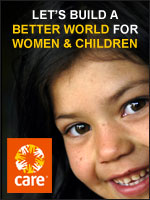


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire