Familles transnationales au quotidien
Élodie Razy (Anthropologue, Université de Liège)
et Virginie Baby-Collin (Géographe, Université de Provence)
Dans un contexte marqué par l’intensification des migrations internationales et par leur résonnance sociale et politique, au Nord comme au Sud, ce numéro se propose d’articuler famille et migration à partir des terrains et des configurations les plus divers, et de réfléchir à la notion de « famille transnationale ». Bien qu’elle apparaisse sous de nombreux vocables (multi-sited family, multi-local binational family, transcontinental family, international family, « famille à distance », « famille dispersée »), ses contours et sa morphologie sont encore trop souvent flous. Peu et diversement définie dans la littérature, la notion de famille transnationale renvoie généralement, dans un contexte migratoire, à au moins deux dimensions : la dispersion géographique des membres de la famille, d’une part, et le maintien de liens étroits entre ces derniers, d’autre part.
Dans les sciences sociales et humaines, la perspective transnationale - nouveau paradigme pour certains, coquille vide pour d’autres -, est aujourd’hui largement utilisée pour étudier de nombreuses dimensions de la vie des migrants, notamment dans les domaines de la sociologie, de l’économie, de la démographie, de la géographie ou encore des sciences politiques. Pour autant, les dynamiques familiales, y sont sous-représentées. De même, certains acteurs ou groupes d’acteurs (élites des pays du Sud et des pays du Nord, enfants, left-behind, returnies…), ainsi que des aires géographiques et linguistiques (Afrique/Europe de l’est…) ou des contextes particuliers (situations de conflit ou de guerre, camps de réfugiés…), sont encore souvent négligés. Si les dynamiques familiales ont fait l’objet d’un traitement contrasté et différencié selon les disciplines et les traditions intellectuelles, leur traitement anthropologique, reposant sur une ethnographie des familles au quotidien, est peu fréquente. En particulier, les répercussions des mouvements transnationaux sur les pratiques familiales restent, à ce jour, peu explorées (Le Gall 2005, 2007 ).
Ce numéro veut offrir une plus grande visibilité aux travaux portant sur la « famille transnationale » ; il accordera une attention particulière à ceux qui seront issus d’études de terrain et qui interrogeront cette notion :
- au niveau des représentations et des pratiques des protagonistes : À partir de quelles définitions locales la famille transnationale se construit-elle ? Comment l’analyser dans le registre du droit (positif ou coutumier) ou encore dans celui du religieux ? Quelle forme concrète revêt une éducation transnationale ? Comment les relations familiales se déploient-elles au quotidien dans et entre différents espaces sociaux, symboliques et juridiques ? Quels sont les modes de gestion de la distance ? Comment se recomposent les mobilités et les territoires du quotidien pour les familles transnationales ?
- au niveau théorique et méthodologique : Quelle est la valeur heuristique de la perspective transnationale dans l’étude des dynamiques familiales ? Comment, en retour, les contours de la famille et la parenté sont-ils interrogés par la notion de famille transnationale ? En quoi les outils spécifiques de l’anthropologie de la parenté ou de l’analyse des réseaux peuvent-ils être féconds ? Comment les familles transnationales ré-interrogent-elles les ancrages spatiaux et les modes de territorialisation à l’heure des mobilités et des « vies à distance » ? Quels sont les apports et les limites d’une « ethnographie multi-site » des familles transnationales ?
Les contributions devraient permettre de mieux comprendre le quotidien des familles dont les membres sont dispersés, et/ou d’apporter des éléments de réflexion théoriques et méthodologiques, à partir des terrains et des configurations les plus divers. La voie pourrait ainsi être ouverte à une conceptualisation plus fine de l’une des déclinaisons contemporaines de la famille et des notions qui servent à l’analyser.
Les propositions de contributions (titre, résumé de 1 500 signes maximum) peuvent être adressées à la revue Autrepart : autrepart@ird.fr jusqu’au 12 Avril 2010.
Élodie Razy (Anthropologue, Université de Liège)
et Virginie Baby-Collin (Géographe, Université de Provence)
Dans un contexte marqué par l’intensification des migrations internationales et par leur résonnance sociale et politique, au Nord comme au Sud, ce numéro se propose d’articuler famille et migration à partir des terrains et des configurations les plus divers, et de réfléchir à la notion de « famille transnationale ». Bien qu’elle apparaisse sous de nombreux vocables (multi-sited family, multi-local binational family, transcontinental family, international family, « famille à distance », « famille dispersée »), ses contours et sa morphologie sont encore trop souvent flous. Peu et diversement définie dans la littérature, la notion de famille transnationale renvoie généralement, dans un contexte migratoire, à au moins deux dimensions : la dispersion géographique des membres de la famille, d’une part, et le maintien de liens étroits entre ces derniers, d’autre part.
Dans les sciences sociales et humaines, la perspective transnationale - nouveau paradigme pour certains, coquille vide pour d’autres -, est aujourd’hui largement utilisée pour étudier de nombreuses dimensions de la vie des migrants, notamment dans les domaines de la sociologie, de l’économie, de la démographie, de la géographie ou encore des sciences politiques. Pour autant, les dynamiques familiales, y sont sous-représentées. De même, certains acteurs ou groupes d’acteurs (élites des pays du Sud et des pays du Nord, enfants, left-behind, returnies…), ainsi que des aires géographiques et linguistiques (Afrique/Europe de l’est…) ou des contextes particuliers (situations de conflit ou de guerre, camps de réfugiés…), sont encore souvent négligés. Si les dynamiques familiales ont fait l’objet d’un traitement contrasté et différencié selon les disciplines et les traditions intellectuelles, leur traitement anthropologique, reposant sur une ethnographie des familles au quotidien, est peu fréquente. En particulier, les répercussions des mouvements transnationaux sur les pratiques familiales restent, à ce jour, peu explorées (Le Gall 2005, 2007 ).
Ce numéro veut offrir une plus grande visibilité aux travaux portant sur la « famille transnationale » ; il accordera une attention particulière à ceux qui seront issus d’études de terrain et qui interrogeront cette notion :
- au niveau des représentations et des pratiques des protagonistes : À partir de quelles définitions locales la famille transnationale se construit-elle ? Comment l’analyser dans le registre du droit (positif ou coutumier) ou encore dans celui du religieux ? Quelle forme concrète revêt une éducation transnationale ? Comment les relations familiales se déploient-elles au quotidien dans et entre différents espaces sociaux, symboliques et juridiques ? Quels sont les modes de gestion de la distance ? Comment se recomposent les mobilités et les territoires du quotidien pour les familles transnationales ?
- au niveau théorique et méthodologique : Quelle est la valeur heuristique de la perspective transnationale dans l’étude des dynamiques familiales ? Comment, en retour, les contours de la famille et la parenté sont-ils interrogés par la notion de famille transnationale ? En quoi les outils spécifiques de l’anthropologie de la parenté ou de l’analyse des réseaux peuvent-ils être féconds ? Comment les familles transnationales ré-interrogent-elles les ancrages spatiaux et les modes de territorialisation à l’heure des mobilités et des « vies à distance » ? Quels sont les apports et les limites d’une « ethnographie multi-site » des familles transnationales ?
Les contributions devraient permettre de mieux comprendre le quotidien des familles dont les membres sont dispersés, et/ou d’apporter des éléments de réflexion théoriques et méthodologiques, à partir des terrains et des configurations les plus divers. La voie pourrait ainsi être ouverte à une conceptualisation plus fine de l’une des déclinaisons contemporaines de la famille et des notions qui servent à l’analyser.
Les propositions de contributions (titre, résumé de 1 500 signes maximum) peuvent être adressées à la revue Autrepart : autrepart@ird.fr jusqu’au 12 Avril 2010.
--







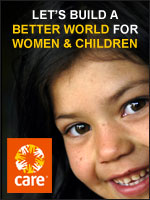


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire